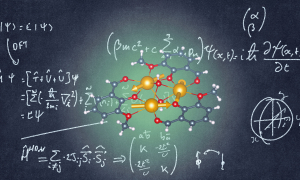La mer est le plus grand musée du monde
De l’estran aux abysses, l’archéologie sous-marine permet de découvrir et protéger les épaves et autres vestiges immergés. Une discipline récente, qui n’aurait pas pu se développer sans les progrès de la technologie.
Sous la houle et les marées, tout au fond des océans, gisent des épaves. Plus de trois millions selon l’Unesco. Derniers vestiges du chaos d’un naufrage, elles reposent depuis des dizaines, des centaines voire des milliers d’années dans leurs cercueils liquides. Comme si le temps s’était arrêté, figeant une époque au fond des océans. Un peu comme si, sous l’eau, les montres ralentissaient. Comme si, dans le silence des abysses, sommeillait un passé invisible, prêt à refaire surface. En 1928, l’archéologue français Salomon Reinach déclare que le fond de la Méditerranée orientale est « le plus grand musée du monde ». Plus tard, ses confrères généralisent le propos. « La mer est le plus grand musée du monde », répète-t-on volontiers chez les archéologues-plongeurs.
Pêcheurs d’éponges et épave antique
Pour s’enrichir ou pour les étudier, l’Homme a toujours cherché les épaves. Dès l’Antiquité, des plongeurs romains sont missionnés par les propriétaires de navires coulés pour récupérer les cargaisons. Mais l’archéologie sous-marine naît véritablement avec la prise de conscience que les épaves n’ont pas uniquement un intérêt commercial. En 1907, la découverte de l’épave de Mahdia, en Tunisie – alors un protectorat français – marque un tournant. Des pêcheurs d’éponges grecs1 trouvent par hasard ce navire du 1er siècle av. J.-C. « On y trouve des antiquités qui attisent l’intérêt de tous les archéologues. Dès lors, on ne peut plus ignorer l’importance du patrimoine sous-marin », raconte Michel L’Hour, conservateur général du patrimoine honoraire et ex-directeur du Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (Drassm).
Il faut cependant attendre 1943 et le perfectionnement par le commandant Cousteau et l’ingénieur Émile Gagnan du scaphandre autonome, inventé au 19e siècle par Rouquayrol et Denayrouze, pour lancer la discipline. C’est grâce à cette avancée qu’est organisée la première fouille méthodique sous-marine au monde, sur l’épave du Grand Congloué, à Marseille. Entre 1952 et 1957, des plongeurs sont envoyés sur le site tandis que les archéologues, pas habilités à plonger, restent sur le pont. C’est en partie ce qui conduit à l’une des plus grandes méprises de l’histoire de la discipline. Les fouilleurs ne saisissent pas pourquoi les objets remontés datent de deux époques différentes. On comprendra vingt ans plus tard qu’il n’y avait pas une, mais deux épaves coulées exactement au même endroit à un siècle d’intervalle.

© TEDDY SEGUIN / DRASSM — Des plongeurs dégagent la coque de l'épave Ouest Giraglia 2, au Nord de la Corse.
Aujourd’hui, les archéologues plongent eux-mêmes sur les sites « pour mieux comprendre leur objet d’étude et appliquer une méthodologie scientifique », souligne Olivia Hulot, conservatrice du patrimoine et responsable des littoraux de Bretagne et de Loire-Atlantique au Drassm.
Au cours du 20e siècle, les épaves sont reconnues comme parties intégrantes du patrimoine, ce qui aboutit en 1966 à la création du Drassm2. La France est le premier pays à se doter d’un tel service et reste leader dans le domaine. Mais qu’est-ce-que le patrimoine ? La notion est mouvante. S’il semble évident que les épaves de la Seconde Guerre mondiale sont entrées dans l’Histoire, ce ne fut pas toujours le cas. « De nombreux navires, parfois chargés de munitions, ont coulé dans des zones peu profondes comme les ports. C’était dangereux et le métal avait un peu de valeur, alors l’État a accordé des concessions de ferraillage à des entreprises pour les déconstruire », explique Michel L’Hour.
Un robot a toute sa place
Depuis ses débuts, l’archéologie sous-marine est intimement liée aux progrès de la technologie. Irène Mopin, post-doctorante en acoustique sous-marine à l’Ensta3 Bretagne, à Brest, est parfois sollicitée pour son expertise et son matériel. « Dans des eaux turbides, comme en Bretagne, on ne voit que quelques mètres devant soi. Il est alors intéressant d’avoir une vue globale d’une épave avec une représentation 3D construite à partir de sonars », explique la chercheuse. Mais certaines sont si enfouies sous le sable qu’elles sont indétectables au sonar. Unique solution : utiliser des magnétomètres, qui repèrent les éléments métalliques. Les scientifiques créent ensuite une carte rassemblant tous les points relevés et devinent la forme d’une coque ou d’un canon à partir du motif dessiné. Et parfois, la technologie permet de remplacer les humains. « À 30 mètres de profondeur, on peut plonger, mais dans des zones dangereuses un robot a toute sa place », indique Luc Jaulin, enseignant-chercheur en robotique marine et sous-marine à l’Ensta Bretagne et au Lab-Sticc4.
Ces applications de la robotique font écho aux projets du Drassm, qui cherche à développer l’archéologie des abysses, pour plonger sous les 300 mètres. « Ce n’est pas une course à la profondeur, c’est une course de vitesse, précise Olivia Hulot. Dans certaines zones, on constate des dégâts irréversibles causés par des engins de pêche qui déstructurent des épaves inédites et parfois particulièrement rares. » En partenariat avec un laboratoire de l’Université de Montpellier, le Drassm a conçu un robot qui expertise les épaves et peut réaliser des prélèvements jusqu’à 2 500 mètres de profondeur. Un projet d’humanoïde avec des mains haptiques5 est également en cours avec l’université californienne de Stanford. « Il y a 20 ans, on n’imaginait même pas faire ça », souffle Michel L’Hour.
Champ de bataille
En parallèle, le Drassm gère le patrimoine immergé en analysant notamment chaque déclaration de découverte (32 en Bretagne en 2022) et en instruisant les dossiers pour des fouilles, des sondages ou des prospections. Il intervient aussi dans une logique préventive avant l’agrandissement d’un port ou l’installation d’un parc éolien et est parfois sollicité par d’autres pays pour son expertise. Ses 37 employés, dont seulement douze archéologues, sont bien trop peu pour balayer les 11 millions de km² d’eaux françaises. Alors le service compte sur des plongeurs amateurs et bénévoles, comme Hugues Priol, à Brest. « Dès que le Drassm nous délivre une autorisation, on fait le dessin du site, de l’épave et des vestiges », indique ce gestionnaire forestier, dont le club de plongée fréquente près de 50 épaves par an.
« La France doit sa place de leader dans l’archéologie sous-marine à la passion des archéologues, confie Michel L’Hour. Ils gèrent l’urgence comme des chirurgiens sur un champ de bataille, classant les blessés entre ceux qu’ils pourront sauver et ceux qui sont déjà perdus. »
1. Surnommés “Pieds Lourds” en référence à leurs chaussures lestées de plomb.
2. À cette date on recense 49 épaves dans les eaux territoriales françaises. En 2009, en partie grâce à l’essor de la plongée sportive et des prospections, on en compte plus de 5 000.
3. École nationale supérieure de techniques avancées.
4. Laboratoire des sciences et techniques de l'information, de la communication et de la connaissance.
5. Des mains sensibles, qui prennent notamment en compte un retour d’effort lors du pilotage.
TOUT LE DOSSIER
du magazine Sciences Ouest